
Tandis que le week-end Bastides en fête, tout juste achevé, célébrait le passé et le présent glorieux de ce patrimoine médiéval local, d’autres réfléchissent à son avenir. C’était justement l’objet du grand séminaire qui s’est tenu jeudi 16 octobre à Monflanquin et que nous avions annoncé dans notre précédente édition. Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) et la préfecture de Lot-et-Garonne ont réuni des élus et des professionnels pour avancer quelques réflexions concernant des aménagements futurs. Des réalisations passées pour en retenir quelques leçons, des chantiers présents présentant des pistes intéressantes, des méthodes utiles pour se donner un cap clair sans oublier les outils d’ingénierie à disposition des élus pour concrétiser leurs projets… La multitude d’interventions et d’exemples a fait jaillir des idées par dizaines. Si elles sont trop nombreuses pour être résumées dans ces colonnes, on peut tout de même en tirer quelques enseignements. Tout d’abord, « le besoin de revitaliser fait consensus », assure Benjamin Glémin, chargé de mission à la Direction départementale des territoires (DDT).
Pas de recette miracle
Une fois l’évidence posée, il faut passer au concret. Une réalité s’impose à tous : « Il n’y a pas de recette miracle. Tous les programmes ne s’adressent pas à tous les contextes urbains », indique l’architecte Maïlys Boutan. À chaque ville, il faut du cousu main. « Cela va même plus loin. Au sein d’une même bastide, chaque pan de quartier possède ses spécificités. On n’interviendra peut-être pas de façon identique d’une rue à une autre. Il ne faut pas dupliquer de manière mécanique, même quand cela a bien marché », complète Jean-Jacques Mirande, président du CAUE. Alors comment faire à partir du moment où la standardisation est proscrite, et pourquoi engager un séminaire collectif ? « Croiser les informations est autant un moyen de s’inspirer que d’éviter les erreurs. On peut piocher ici et là des idées intéressantes en profitant du recul et de l’expérience des autres. Il est également indispensable de se laisser un peu de temps pour mûrir ses réflexions et construire avec ses habitants. L’aménagement urbain, c’est du long terme, et cela ne fait pas bon ménage avec la précipitation. Pour autant, même si cela peut paraître paradoxal, il faut aussi accepter de se lancer sans détenir la vérité. Cela demande du courage, notamment politique », estime Jean-Jacques Mirande. Ce courage peut consister à détruire des éléments patrimoniaux, judicieusement choisis, pour en faire respirer d’autres. Ces sacrifices peuvent se transformer en opportunités. On peut le voir actuellement à Villeneuve-sur-Lot avec plusieurs démolitions en cours.
Penser la réversibilité

L’architecte Christophe Libault, aujourd’hui conseil de l’État, se souvient quant à lui des travaux auxquels il a participé à l’aube du XXIe siècle, avec peut-être une surutilisation de la minéralité, et ce même si les arbres de la place des Arcades avaient été conservés. « En 2000, la question du réchauffement climatique ne se posait pas. C’est là que l’on voit les différences de regards et de pratiques entre des époques finalement pas si éloignées », explique-t-il. C’est pourquoi l’une des conditions à poser désormais, selon les spécialistes, relève de la « réversibilité », c’est-à-dire pouvoir s’adapter a posteriori à des changements que l’on n’aurait pas pu anticiper. Dans la continuité, « la mixité des programmes est essentielle, note Maïlys Boutan. Si l’on fait de l’habitat, combien de logements et quelle configuration ? Idem si l’on part sur un cabinet médical. Quelle utilisation du rez-de-chaussée ? Garage, commerce, pièce utile ? La réflexion doit toujours aller plus loin que la demande du moment et le périmètre de la parcelle. »
La vacance des logements, qui peut atteindre 40%, et leur insalubrité pour certains, est un élément très préoccupant pour les décideurs publics. Les bailleurs sociaux, historiquement peu présents dans ces zones géographiques, sont de plus en plus sollicités pour assurer une montée en gamme de l’offre. L’idée de sortir du modèle studio ou T1 bis sous les toits au profit d’habitations plus adaptées aux seniors et aux familles gagne également du terrain, avec la volonté d’apporter plus de lumière et des jardins quand cela est possible. L’attractivité va de pair avec la facilité à se garer pour les résidents. Ce sujet central doit aussi tenir compte des nouveaux usages de recharge électrique, qui tend plus à devenir quotidienne qu’occasionnelle.
L’Architecte des bâtiments de France : censeur ou garde-fou ?
Dans la plupart des opérations touchant au cœur des bastides, il faut obtenir l’aval de l’architecte des bâtiments de France (ABF). En Lot-et-Garonne, il s’agit de David Morisset et de son équipe. « Déjà, il faut distinguer les bastides relevant d’un site patrimonial remarquable et les autres. Les contraintes ne seront pas les mêmes. Quoi qu’il en soit, nous sommes dans une logique de dialogue avec les porteurs de projet. L’instauration d’un dialogue dès le départ permet de trouver plus rapidement des solutions pour à la fois préserver le patrimoine ancien et répondre aux enjeux contemporains. Notre connaissance du bâti ancien, qu’il présente une grande valeur historique ou pas, sert de guide. L’objectif est de trouver le bon programme pour le bon immeuble. Nous sommes notamment là pour éviter de commettre des erreurs que l’on regretterait plus tard. Mais nos conceptions évoluent aussi, et les règlements avec. Ils sont sans cesse réinterrogés, recomposés. Sur les panneaux solaires, on a conscience qu’on ne peut pas camper sur des positions trop anciennes. On n’est pas dans un cadre figé », explique David Morisset.













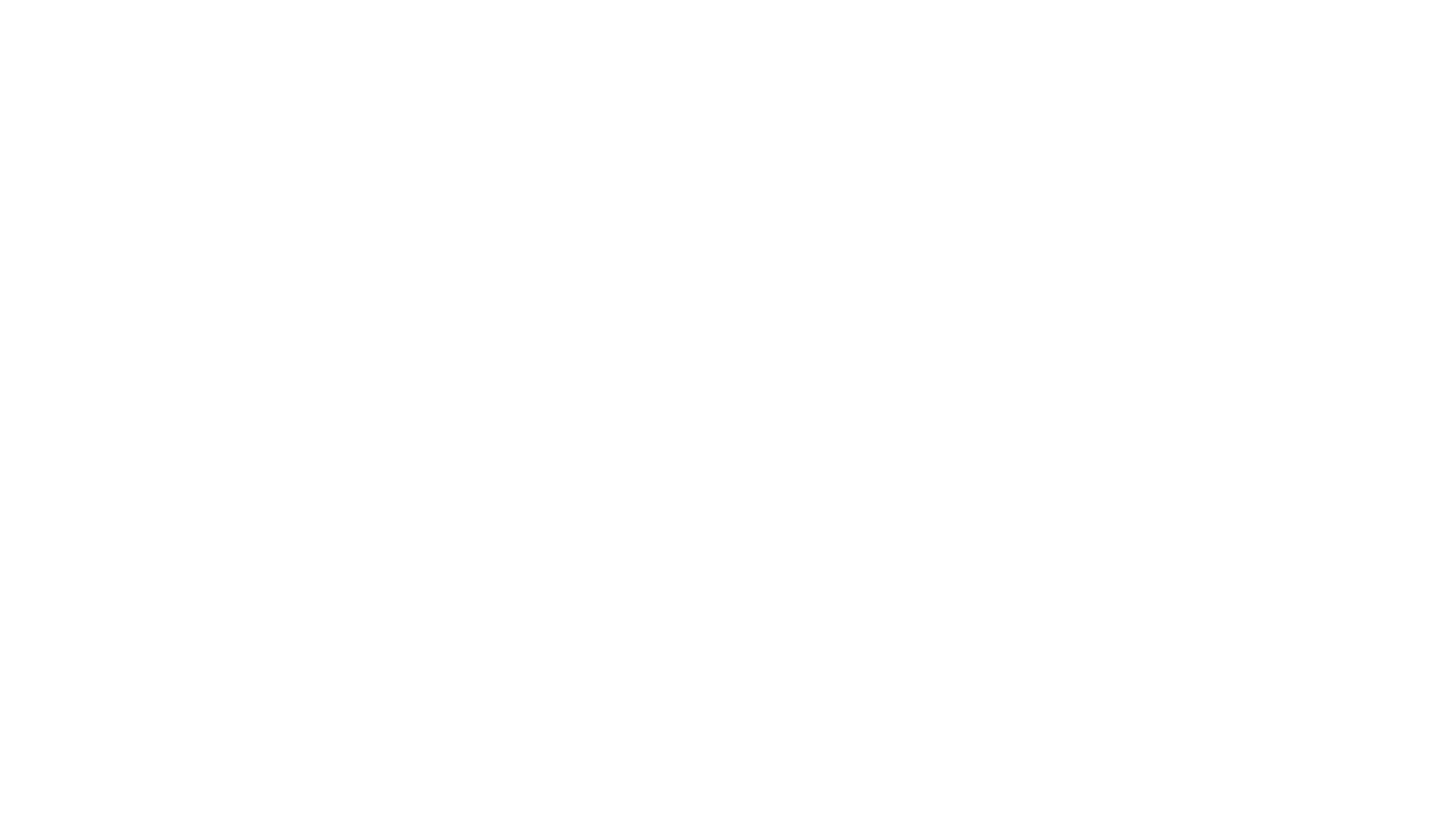
Laisser un commentaire