
©Archives départementales de Lot-et-Garonne
Le sextuple crime de Moirax
Le 9 février 1932, le paisible village de Moirax, à une dizaine de kilomètres d’Agen, découvre l’un des faits divers les plus marquants de l’histoire du Lot-et-Garonne. Dans la villa Delafet, au hameau de Serres, six membres d’une même famille sont retrouvés massacrés : la grand-mère, la mère, l’oncle, l’épouse et les deux enfants, âgés de neuf ans et trois mois. Les gendarmes, alertés par des voisins inquiets de ne voir personne s’affairer ce matin-là, font face à une scène d’une extrême violence. Tout indique un acte prémédité, exécuté avec plusieurs armes : fusil, couteau et hache. Le seul absent, Pierre-Michel Delafet, fils et père de famille âgé de 31 ans, est rapidement identifié comme suspect principal.

Arrêté à Clairac, où il s’était réfugié après le drame, Delafet avoue sans résistance. Il décrit avec un calme glaçant le déroulement des faits, commis dans la nuit du lundi au mardi, avant de reprendre sa bicyclette pour regagner Clairac avant l’aube. L’affaire provoque un émoi considérable dans tout le département. Le procès, ouvert à Agen le 6 mars 1933, se déroule sous haute tension. L’accusé, décrit par les témoins comme taciturne et instable, ne manifeste ni remords ni émotion. Les débats se concentrent sur son état mental : folie ou pleine responsabilité ? Trois experts psychiatres se contredisent, mais le jury retient la préméditation. Pierre-Michel Delafet est condamné à mort. Le 8 novembre, à l’aube, il est guillotiné dans la cour du Fort du Hâ. Ce sera l’une des dernières exécutions publiques de la région. À Moirax, l’affaire laisse une empreinte durable. La maison du crime, longtemps évitée, finit par disparaître.
L’affaire Crespy : le « drame d’Agen » qui fit scandale

Le 17 janvier 1913, à Agen, le vicaire de l’église Saint-Hilaire, l’abbé Germain Chassaing, est retrouvé mort dans l’appartement de sa maîtresse, la poétesse Alice Crespy, rue Fon-Nouvelle. Une balle dans la tempe, un revolver à ses côtés : accident, suicide ou meurtre ? Très vite, la police privilégie la dernière hypothèse. L’amante, 40 ans, célibataire et indépendante, est arrêtée et renvoyée devant la cour d’assises. Le procès, ouvert le 4 août 1913, déchaîne les passions. La foule se presse devant le palais de justice, huant l’accusée. L’audience se tient dans un climat tendu. Les experts jugent le suicide “inadmissible”, mais aucune preuve ne relie formellement Alice Crespy au tir fatal. Interrogée, elle décrit une liaison passionnée, née au confessionnal quatre ans plus tôt. Les témoins, eux, brossent le portrait d’une femme exaltée et libre, image mal tolérée dans la société provinciale de l’époque. L’avocat général plaide la faute morale d’une “femme pervertie” ayant entraîné un prêtre faible à sa perte. En face, Maître Dozon de Noyer démonte les failles de l’enquête : aucune empreinte sur l’arme, aucune preuve de préméditation. “Si vous la condamnez, c’est la mort pour elle et sa famille, mais je ne demande pas la pitié : elle est innocente.” Après vingt minutes de délibération, le jury acquitte Alice Crespy. Le “drame d’Agen”, qui avait passionné la presse nationale, s’achève dans le tumulte.
Le triple meurtre d’Allemans

En novembre 1878, le village d’Allemans, près de Miramont, est bouleversé par un triple meurtre. Dans leur ferme, le père Laprade, 44 ans, sa femme Justine, 38 ans, et la grand-mère, 83 ans, sont retrouvés massacrés à coups de fusil et de serpe. Rien n’a été volé, et la violence du crime laisse le village sans voix. Très vite, les soupçons se portent sur le fils unique, Jean, un jeune homme de vingt ans, réputé paresseux et querelleur. Les disputes avec son père étaient notoires, et il avait souvent promis « qu’un jour, il s’en débarrasserait ». Les gendarmes découvrent dans la mare un fusil brisé dont la crosse correspond à un morceau trouvé près des corps. C’est l’arme du jeune Laprade. Des témoins assurent qu’il avait proposé de l’argent pour « faire disparaître » ses parents. Arrêté, il nie farouchement, mais les jurés ne sont pas convaincus. Le 5 mars 1879, après un procès très suivi, il est condamné à mort sans circonstances atténuantes. Le 19 mai, à l’aube, la guillotine est dressée place du Pin à Agen. Six mille personnes assistent à l’exécution. Le Lot-et-Garonne n’avait pas connu pareille exécution depuis vingt-neuf ans.
Le crime de Rigoulières
Un matin de février 1919, à Rigoulières, à proximité de Penne-d’Agenais, le pêcheur Jean Desplat, que tout le monde appelle Alban, disparaît sans laisser de trace. Son ami Germain Choisy, inquiet de ne pas le voir, alerte les voisins puis le maire. Le bateau d’Alban est toujours amarré, la maison fermée. On force la porte : rien n’a bougé, sinon l’argent du pêcheur, introuvable. Les gendarmes fouillent les berges, le fleuve, les environs : pas de corps, pas d’indice. L’affaire s’enlise, et en 1920, le juge de Villeneuve prononce un non-lieu. Quatre ans plus tard, une voisine, Jeanne Mourlès, rapporte une violente dispute entre un certain Jean Fontagné et son fils Pierre : « C’est toi qui l’as tué ! » aurait crié l’un. L’enquête rouvre. Les Fontagné nient tout, mais les langues se délient. Le jeune Jean-Élie Lacombe, sous l’influence du père et du fils, finit par raconter l’invraisemblable : c’est lui qu’on avait envoyé chercher Desplat sous prétexte d’une partie de chasse. Le vieux pêcheur, attiré vers la rivière, a été abattu de deux coups de fusil avant d’être lesté de pierres et jeté dans le Lot. En novembre 1924, Jean et Pierre Fontagné comparaissent devant la cour d’assises d’Agen. Le père, colérique et insultant, nie l’évidence et accuse tour à tour voisins et complices. Le fils, plus effacé, plaide la peur. Les jurés ne sont pas dupes : Jean Fontagné est condamné à mort, son fils à huit ans de réclusion. Quant au jeune Lacombe, il est acquitté sous les applaudissements du public.













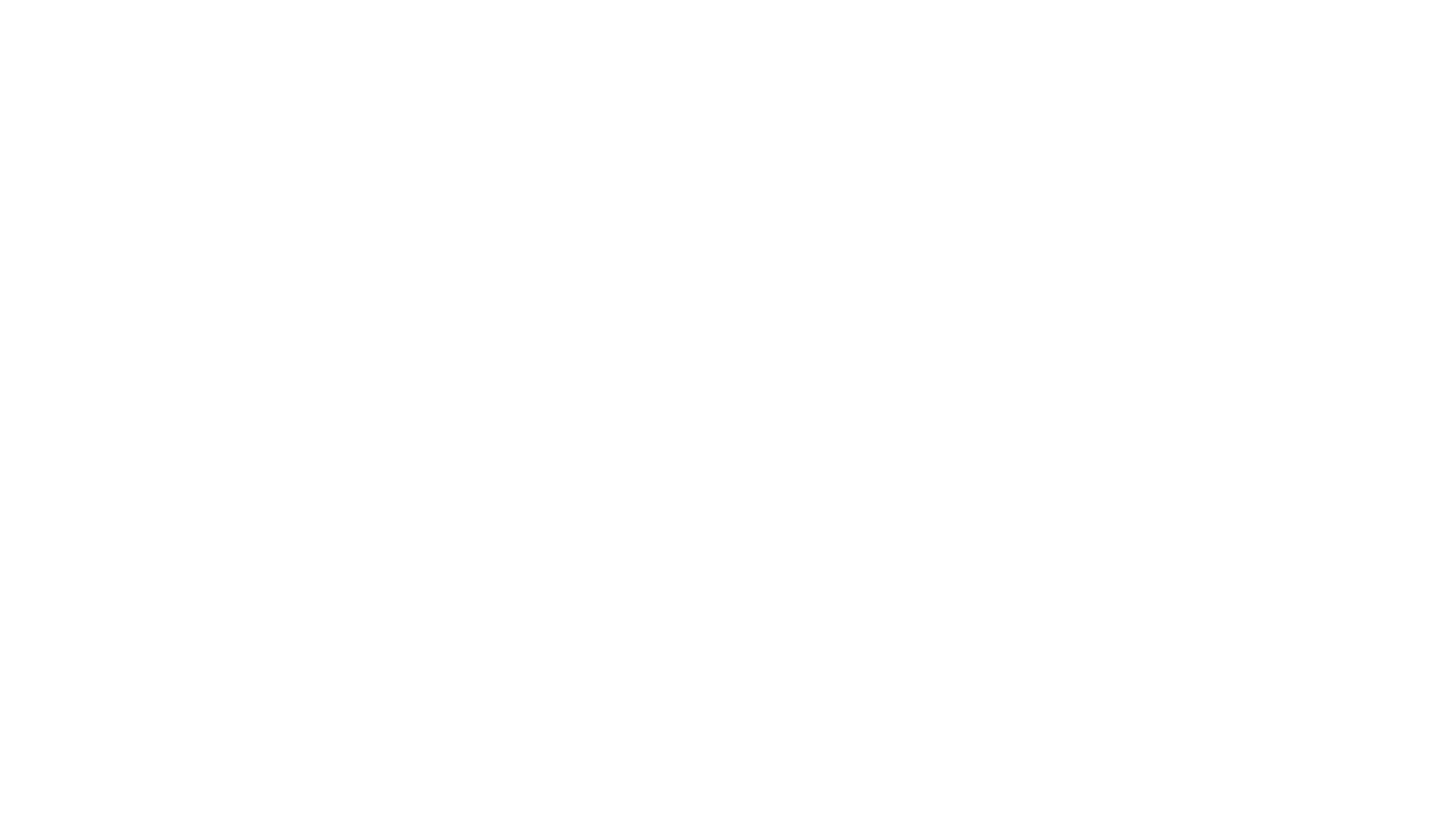
Laisser un commentaire