1976, quand le Lot-et-Garonne priait pour la pluie


Dans la mémoire collective, l’été 1976 demeure une cicatrice brûlante. Après un hiver anormalement sec, les nappes phréatiques n’ont pas eu le temps de se remplir. À peine le printemps arrivé, le thermomètre grimpe déjà à des niveaux inédits : plus de 30 °C en mai, puis 33 °C à Agen en juin, sans une goutte de pluie pour apaiser les terres assoiffées. Les champs se dessèchent, les forêts s’embrasent, et les cultivateurs du Lot-et-Garonne voient leurs espoirs de récoltes s’effondrer. L’armée est appelée en renfort pour approvisionner les villages en eau potable, pendant que des trains spéciaux, chargés de paille, sillonnent la région pour sauver ce qui peut l’être du cheptel. Même le pape Paul VI dit implorer le ciel, mais rien n’y fait : la canicule persiste et l’on enregistre localement jusqu’à 40 °C début juillet. Les rares orages d’été, violents et localisés, ne font qu’aggraver les dégâts. Les agriculteurs, déjà à bout de forces, subissent jusqu’à 30 % de pertes sur les céréales. Pour faire face, le gouvernement débloque une aide d’urgence de 2,2 milliards de francs, financée par le fameux « impôt sécheresse » qui scandalise et conduit à la démission du Premier ministre Jacques Chirac. À la fin de cette saison infernale, la mortalité a bondi de 10% dans le département, signe d’une catastrophe d’ampleur historique.
1875, quand Agen connaissait la crue du siècle //


Juin 1875. Agen savoure alors un début d’été radieux : soleil généreux, foire d’été animée, élégantes et élégants déambulant sur le Gravier au son des fanfares. Mais l’allégresse va brutalement céder la place à l’effroi. En quelques jours, des pluies diluviennes s’abattent sur le bassin, grossissant la Garonne et ses affluents jusqu’à l’inimaginable. Dans la nuit du 23 au 24 juin, le fleuve déborde avec une violence inouïe, atteignant une cote record de 11,75 mètres et un débit monstrueux de plus de 8 000 m³/s. Agen disparaît sous les eaux, ne laissant émerger que quelques rares points hauts : les Jacobins, le lycée (actuel collège Chaumié) et la halle en bois. Les petites maisons en bord de Garonne sont arrachées, emportant parfois leurs occupants dans un tourbillon mortel. Au matin, le bilan est lourd : huit morts et une ville méconnaissable, recouverte d’un voile boueux et silencieux. Le président de la République d’alors, le maréchal Mac-Mahon, de passage à Agen, se contente d’un « Que d’eau, que d’eau… », formule restée tristement célèbre tant elle paraît dérisoire face à l’ampleur du désastre. Encore aujourd’hui, cette crue hors normes reste gravée comme le plus grand drame de l’histoire agenaise, « la guerre exceptée », rappelant à chaque génération la puissance imprévisible du fleuve.
1930, quand Garonne refaisait des siennes //

Mardi 4 mars 1930. Tandis que le carnaval battait son plein, Agen se préparait sans le savoir à vivre l’une des pages les plus sombres de son histoire. En quelques heures, la Garonne s’est transformée en monstre impétueux, charriant troncs, animaux morts et meubles, envahissant la ville « à la vitesse d’un cheval au trot » selon la presse de l’époque. Dès l’aube, les Agenais, résignés, montent aux étages, voient leurs rues se changer en torrents. À 14 heures, la cité est presque entièrement submergée : le quartier Sembel se mue en lac, le Gravier ressemble à une mer de boue, tandis que la rue Cale Abadie est dévastée comme après une explosion. L’eau monte jusqu’à 3 mètres boulevard Carnot.

On croise des habitants réfugiés sur les toits ou dans le cimetière de Monbusq, d’autres forcés de « boire du vin » sur conseil de la mairie pour survivre, l’eau potable s’étant raréfiée. À 18 heures, la Garonne atteint son point culminant à 10,86 mètres, avant d’amorcer enfin sa décrue dans la nuit. Agen se retrouve isolée, sans routes ni électricité. Bien que Moissac paie le tribut le plus lourd avec près de 300 morts, cette inondation marquera à jamais la mémoire agenaise. Après ce « mardi-gras maudit », la ville mettra des années à se relever. Aujourd’hui encore, les photographies archivées sont restées pour le moins iconiques dans l’histoire de la ville.
2009, quand Klaus soufflait sur le département

Le 24 janvier 2009, le Lot-et-Garonne se réveille en pleine nuit sonné par le passage brutal de la tempête Klaus. Au petit matin, le paysage est méconnaissable : arbres déracinés, toitures envolées, routes encombrées de branches brisées. Sur la D933, entre Houeillès et Casteljaloux, ou encore sur l’axe Nérac-Mézin, la circulation est impossible, la forêt landaise voisine ayant littéralement été couchée par les rafales. À Agen, place Jasmin, le toit d’un garage s’est effondré, et à Bruch, la salle des sports s’est envolée avant d’atterrir sur le toit de l’école voisine, miraculeusement vide ce samedi-là. Au château d’Allot, à Boé, le chapiteau s’est volatilisé, emporté par le vent. Les pompiers, débordés, reçoivent plus de 7 000 appels en quelques heures. Partout, le même constat : 101 000 foyers privés d’électricité et des villages coupés du monde. Mais c’est surtout le monde agricole qui paiera le plus lourd tribut : vergers de pruniers renversés, serres éventrées ou envolées, élevages avicoles décimés. Trois semaines plus tard, le bilan est vertigineux : près de 40 millions d’euros de dégâts, dont 6 millions rien que pour les fraises, 4 millions pour les infrastructures, et plus de 8 millions pour l’aviculture. Si Klaus a frappé plus fort ailleurs, notamment dans les Landes, le Lot-et-Garonne garde le souvenir amer de cette nuit où le vent a tout balayé, laissant derrière lui des villes assomées.












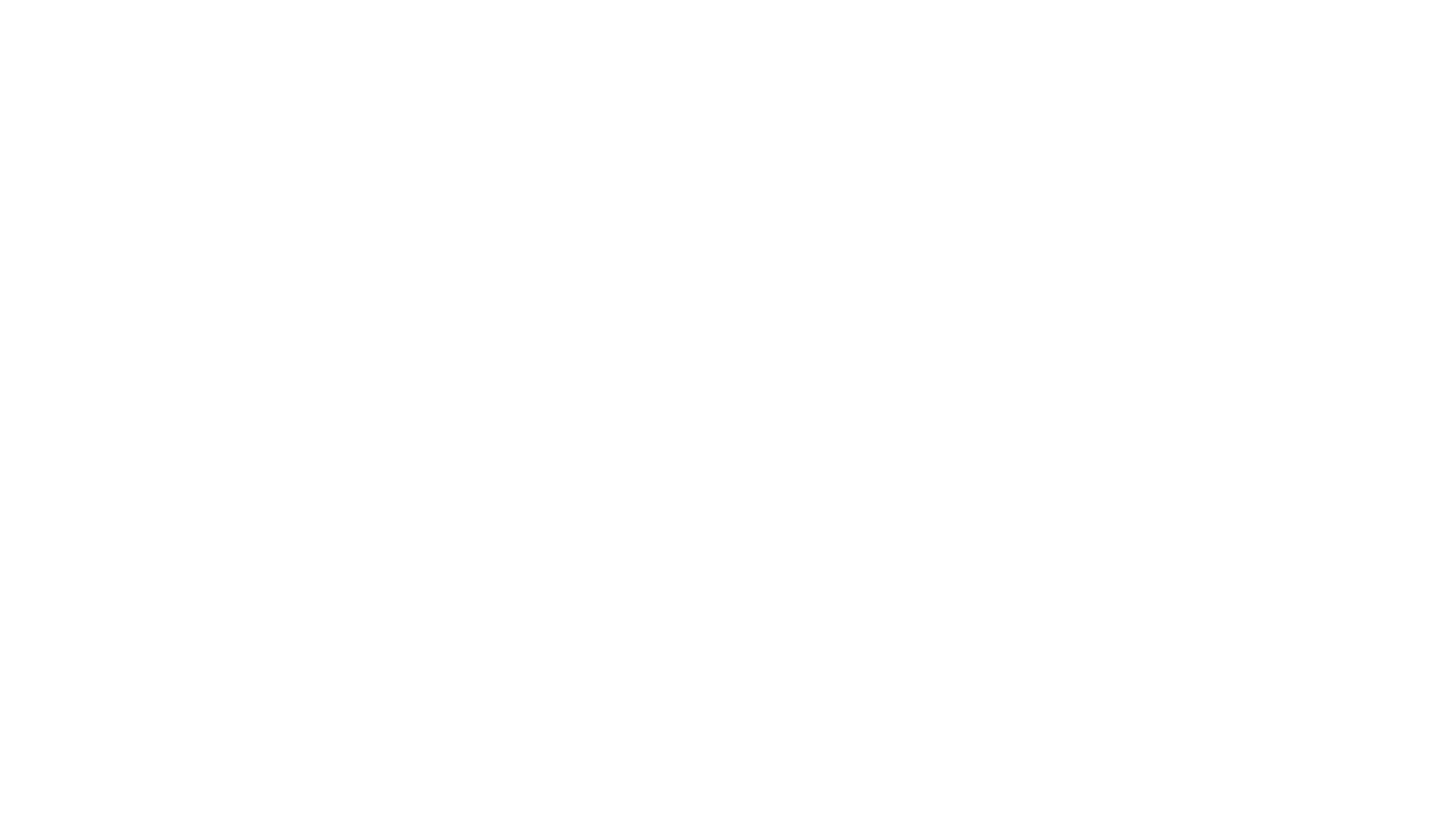
Laisser un commentaire